Le milieu éducatif est depuis longtemps friand de technologies. Pensez aux rétroprojecteurs, à Internet ou aux visioconférences. En outre, les recherches sur l’IA en éducation (IAEd) ont commencé il y a plus de 50 ans. Mais c’est dans les années 2010 que la personnalisation de l’apprentissage par l’IA a véritablement pris son essor. Khan Academy, par exemple, a su exploiter de grandes quantités de données d’apprentissage pour adapter les contenus à des besoins individuels. La nouveauté aujourd’hui, c’est que les outils les plus utilisés — ChatGPT, Copilot, Gemini, entre autres — ne sont pas spécifiquement éducatifs. Et pourtant, ils investis-sent massivement les salles de classe, souvent sans encadrement clair.
L’éducation à l’épreuve de la machine
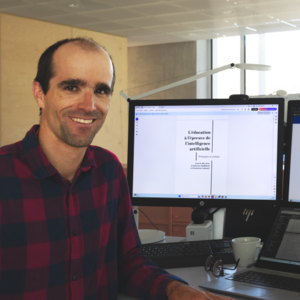
Ambroise Baillifard, co-auteur de l'ouvrage et collaborateur scientifique chez UniDistance Suisse

Henrietta Carbonel, co-autrice de l'ouvrage et collaboratrice scientifique chez UniDistance Suisse
IA et éducation: ces deux thèmes ne sont-ils pas contradictoires?
Pourquoi avoir choisi d’aborder le thème de l’IA spécifiquement dans le contexte éducatif?
Il est périlleux de se soustraire à la thématique, car l’IAg, qu’on le veuille ou non, s’immisce partout. Elle alimente les moteurs de recherche, trie nos courriels, corrige nos textes, recommande des contenus, prédit nos comportements… L’enseignement est mis à l’épreuve notamment parce que l’utilisation de l’IAg présente un risque de péjorer les apprentissages. De plus, cette omniprésence est discrète. Ainsi, dans bien des cas, la contribution d’un outil d’IAg à un travail étudiant échappe à toute détection fiable. Certaines institutions envisagent de renforcer les dispositifs de contrôle, au prix d’une pédagogie du soupçon, contraire à toute relation éducative fondée sur la confiance et la responsabilité.
On devine que les réponses binaires «autoriser ou interdire» ne fonctionnent pas. On ne peut autoriser des usages qui nuisent à l’apprentissage et à la construction des habiletés cognitives. On ne peut pas non plus interdire ce qui s’impose partout. Il reste aux enseignants et décideurs à jouer aux équilibristes.
Entre enthousiastes et sceptiques, qui a les arguments les plus solides?
À l’égard de l’IAg en éducation, tout dépend de l’utilisation qu’on en fait, pour quel apprentissage, dans quel contexte. Prenons ChatGPT parce qu’il est l’outil le plus utilisé. Véritable cyber couteau suisse, il promet mille usages. Originellement conçu pour simuler la conversation humaine, il peut résumer un texte, le traduire, donner un feedback, créer des exercices, questionner au sujet d’un cours, résoudre un devoir, produire du code, générer des données fictives… Certains de ces usages peuvent être bénéfiques dans certains contextes, d’autres délétères. À l’instar d’un couteau suisse, Chat GPT n’est ni bon ni mauvais. Du pur point de vue éducatif, les louanges et la méfiance dépendent donc de ce que l’on veut bien regarder.
L’étudiant est-il voué à se reposer sur ses lauriers?
Ils peuvent s’ils le veulent. «Être voué» signifie «être condamné à» ou «être promis à». Personne n’est condamné à se reposer sur ses lauriers. Toutefois, on n’apprend pas sans peine. On ne devient pas juriste, médecin ou mathématicien sans s’exercer longuement, laborieusement parfois, aux compétences de son métier. Il est possible d’utiliser l’IAg comme un levier pour apprendre efficacement, mais s’en servir comme palliatif à l’effort ne peut qu’atrophier l’apprentissage. Sur cette voie, les perspectives s’obscurcissent. La majorité de nos étudiants et étudiantes veulent apprendre, il nous faut les aider à utiliser l’IAg à bon escient.
À propos de l’ouvrage
«L’éducation à l’épreuve de l’intelligence artificielle» explore les usages émergents de l’IA dans l’enseigne-ment supérieur: génération automatique d’examens, soutien personnalisé à l’apprentissage, dispositifs pédagogiques repensés… Les auteurs analysent les impacts concrets sur les étudiants, les enseignants et les institutions. Quelles sont les pratiques qui se transforment et les résistances qui émergent? Quelles régulations mettre en place? Destiné aux enseignants, chercheurs, responsables pédagogiques et décideurs académiques, l’ouvrage offre des repères pour comprendre et accompagner l’intégration raisonnée de l’IA dans l’univers éducatif.
Accéder gratuitement à l’ouvrage en open access sur le site de l'EPFL Press





